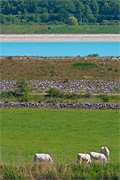Mine/Saline
Einville-au-Jard
Saline d'Einville
Il s'agit de la saline Sainte-Marie, elle a débutée en 1871 (concession la Sablonière). Le sel est ici extrait par dissolution, puis stocké dans des "poêles" (ce sont des bassins) qui sont chauffés. Le sel peut ensuite être récolté.
La saline rejoint le groupe "Coopérateurs de Lorraine" en 1922 avant de redevenir indépendante en 1988.
SEM : Saline Einville Maixe
Saline Saint-Laurent
La saline Saint-Laurent démarre la même année que Sainte-Marie, elle était exploitée comme à Varangéville, c'est à dire par puits et en chambres et galeries de 10 à 15m de largeur sur 4.5m de hauteur. L'extraction annuelle était de 350 000 quintaux qui étaient utilisés dans l'industrie et dans l'agriculture. Elle cessa toute extraction durant la Première Guerre Mondiale, mais ses activités furent définitivement fermées en 1965. Aujourd'hui tous les bâtiments ont été détruit il reste encore le chevalement appartenant à la CSMSE.
Lenoncourt
 Ce chevalement comme celui d'Einvile est une tour dite de sondage, ces constructions de bois et de parpaings sont les seules traces restantes du début de l'extraction du sel dans le bassin. Elles mériteraient d'être préservées et mises en valeur.
Ce chevalement comme celui d'Einvile est une tour dite de sondage, ces constructions de bois et de parpaings sont les seules traces restantes du début de l'extraction du sel dans le bassin. Elles mériteraient d'être préservées et mises en valeur.
 Cet ancien sondage porte le numéro 22. La différence de hauteur entre ces deux sondages par exemple est significative, ce mode d'extraction nécessite deux puits :
Cet ancien sondage porte le numéro 22. La différence de hauteur entre ces deux sondages par exemple est significative, ce mode d'extraction nécessite deux puits :
- L'un pour l'injection d'eau.
- L'autre pour l'extraction de la saumure.
Il fallait tout simplement une hauteur suffisante pour pouvoir installer une pompe. On peut donc distinguer l'utilité de chaque sondage.
 Il faut alors s'imaginer qu'il y avait plusieurs de ces tours de ce style dans le paysage, toutes plus ou moins alignées. Il reste encore plusieurs traces des fondations de ces sondages.
Il faut alors s'imaginer qu'il y avait plusieurs de ces tours de ce style dans le paysage, toutes plus ou moins alignées. Il reste encore plusieurs traces des fondations de ces sondages.
Sommerviller
Saline Jeannette
La commune a connu deux salines :
- Celle de Sommerviller fondée en 1857 par Pierre-Marie Mouet
- Celle dite de la Jeannette fondée en 1872 par Mr Durnesse
Ces deux salines sont construites au bord du canal de la Marne au Rhin, chacune d'un côté.
Le site de la Jeannette a été vendu à la saline d'Einville en 1934 et ses installations furent totalement démolies en 1967, il ne reste aujourd'hui que des vestiges de murs et sondages. La saline de Sommerville disparaît dans les années 1960, au profit de la Société Salinière de l'Est et des salines de Meurthe et Moselle, il ne reste aucun vestiges excepté une micro cité ouvrière de quelques maisons jointives.
Varangéville
Saline Saint Nicolas
La mine de Varangéville (concession de Saint-Nicolas) est aujourd'hui la dernière mine de sel Française encore en activité.
Les premières concessions pour Varangéville sont accordés en 1845. Deux exploitants vont se partager ces concessions :
- Société Daguin et Cie
- Société des Salines de Rosières-Varangéville. (Puis Saline Maugras en 1868)
La société Daguin et Cie est crée en 1855. La saline est crée la même année, un premier puits est foncé, le Saint Maximilien, le fonçage du puits Saint Jean Baptiste ne commence qu'en 1869, sa profondeur est de 160m. En 1884 la société Daguin et Cie devient Société Marcheville Daguin et Cie.
La Société Salinière Lorraine est crée en 1944 elle loue puis achète la mine. En 1961 elle devient Société Salinière de l’Est en rachetant plusieurs salines, puis en 1967 Société Salinière de l’Est et du Sud-Ouest (regroupement de salines du Sud Ouest) et l'année suivante nait de la fusion des salines de l'est, la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l’Est.
On produit à peu près 500 000 tonnes de sel par an.
On estime la taille du gisement à au moins de 400 kilomètres carrés, dont l'épaisseur varie entre 15 et 70 mètres, qui se subdivisent en 11 couches, dont une seule est exploitée, sa puissance est de 16 mètres. Aujourd'hui 200 kilomètres de galeries on déjà été exploitées, le front de taille se situe à 5 kilomètres du puits. Et l'exploitation continue toujours...au moins jusqu'en 2025 le tout grâce à 60 mineurs.
 Le puits d'extraction est caché derrière ces tôles, il sert à la descente du personnel, à l'extraction et comme retour d'air. Il descend à 160 mètres.
Le puits d'extraction est caché derrière ces tôles, il sert à la descente du personnel, à l'extraction et comme retour d'air. Il descend à 160 mètres.
 Le puits RV (Rosières - Varangéville), (concession Rosieres-Varangéville) est foncé en 1872, sa profondeur est de 125m. Initialement crée par la Société des Salines de Rosières-Varangeville, il servait comme puits d'extraction, aujourd'hui il appartient à la CSMSE, mais ne sert plus (juste retour d'air également) C'est le puits le plus éloigné. En souterrain ces galeries sont aujourd'hui également relié à la mine de Varangéville. Juste pour l'indiquer, la concession Rosières-Varangéville est la concession la plus ancienne de Meurthe et Moselle.
Le puits RV (Rosières - Varangéville), (concession Rosieres-Varangéville) est foncé en 1872, sa profondeur est de 125m. Initialement crée par la Société des Salines de Rosières-Varangeville, il servait comme puits d'extraction, aujourd'hui il appartient à la CSMSE, mais ne sert plus (juste retour d'air également) C'est le puits le plus éloigné. En souterrain ces galeries sont aujourd'hui également relié à la mine de Varangéville. Juste pour l'indiquer, la concession Rosières-Varangéville est la concession la plus ancienne de Meurthe et Moselle.
La machine d'extraction est une machine à tambour à câble plat.
Pour résumer il y a donc trois puits :
- P1 : Puits d'entrée d'air et de secours.
- P2 : Puits d'extraction de deux cages sur deux étages, de service et de retour d'air (Puits Saint Jean Baptiste)
- P3 : Puits de service et retour d'air (Puits de Rosières)
Autre
 Ancienne saline au sud de Tonnoy actuellement en pleine reconversion.
Ancienne saline au sud de Tonnoy actuellement en pleine reconversion.
Soudières
Dombasle-sur-Meurthe
La soudière Solvay est fondée en 1873, elle tire son nom d'un chimiste belge Ernest Solvay, qui a inventé un procédé destiné à obtenir du carbonate de sodium. Ce procédé est économique (le sel et le calcaire sont facilement trouvables) et moins polluant (l'ammoniac est recyclé pendant la réaction).
 L'usine est immense, elle s'étend sur presque un kilomètre de longueur, et possède des appareils démesurés tels que :
L'usine est immense, elle s'étend sur presque un kilomètre de longueur, et possède des appareils démesurés tels que :
- Ces trois énormes fours à chaux de 27m de hauts, construits en 1900, ils servent à la calcination du calcaire, celui-ci était extrait des carrières de Maxéville par TP MAX (Transport aérien de Maxeville), long de 18km il a transporté pendant 60 ans près de 50 millions de tonnes de calcaire, grâce à ses 800 bennes avant de s'arrêter en juin 1984.
- Un énorme pont transbordeur perché à 70m de hauteur du canal de la Marne au Rhin afin d'alimenter ces fours.
- Les énormes bâtiments de 15 étages qui abritent les carbonateurs.
- Un bassin de décantation d'une capacité de 5 millions de mètres cubes.
Pas étonnant donc que cette soudière soit la troisième plus grande d'Europe. Elle produit entre autre 700 000 tonnes de carbonate et 120 000 tonnes de bicarbonate de soude.
 Voici la dernière benne se trouvant à Varangéville !
Voici la dernière benne se trouvant à Varangéville !
Et près de la carrière à ciel ouvert toujours en activité se trouve un petit tronçon du TP Max, dernier vestige de ce transporteur.
Laneuveville-devant-Nancy
La soudière de la Madeleine est crée en 1881 par Ernest Daguin, qui veut, en plus de la mine Saint Nicolas, développer un nouveau produit à partir du sel : le carbonate de sodium. Après des essais très concluants (notamment en y ajoutant de l'ammoniac), la soudière s'installe près de Varangéville.
Depuis la moitié du 20ème siècle, l'usine changea de nom plusieurs fois en fonction des diverses fusions, de Saint Gobain jusqu'à devenir une filiale de Rhône-Poulenc en 1996, Novacarb était né. Depuis 2000 c'est la société américaine Bain Capital qui en est majoritairement propriétaire.
Dans les bassins de décantation il reste encore l'ancienne cheminée de la précédente saline (Saline Annexe) millésimée 1874 ainsi que les initiales pour Saint Gobain.
Château-Salins
Salines de Château-Salins
Le nom du chef-lieu du Saulnois évoque directement son histoire. Dans les années 1340, le duc de Lorraine fît bâtir une forteresse qu'on appela le "Chastelsalin" afin de protéger la précieuse source salée découverte en ces lieux.
Deux salines furent en exploitation dans la commune :
- La première saline fonctionna jusqu'en 1826, c'est celle qui se trouvait en centre ville.
- La seconde fût édifiée en 1892 par Tillement et Nicolas et rachetée en 1900 par Solvay afin d'y produire de la soude jusqu'en 1945.
 Les deux premières photos montrent le site de la première saline, le seul vestige est un pan de mur d'un des bâtiments abritant une poêle à sel.
Les deux premières photos montrent le site de la première saline, le seul vestige est un pan de mur d'un des bâtiments abritant une poêle à sel.
La seconde saline a été entièrement démolie et seul reste un petit bâtiment en briques qui servait à l'entretien du matériel ferroviaire.
Dieuze
Les salines de Dieuze sont mentionnées comme étant les plus anciennes sources salées exploitées, elles produisent effectivement du sel à partir de 803 lorsqu'elles appartiennent aux dépendances de l'abbaye de Saint-Maximin de Trèves. Elle est à ce jour également la seule saline et la plus conséquente, en terme de vestiges, qui soit encore visible de nos jours.
A partir du 11ème siècle, la ville et les salines sont sans doute cédées à l'évêque de Verdun, les salines deviennent épiscopales. Les ducs de Lorraine comprennent très vite l'intérêt financier des salines, ils vont tenter de mettre la main dessus pendant près de 200 ans et obtiennent des droits sur l'église, en 1296 le duc Ferri III prend en bail la partie des salines de Dieuze aux mains de la Collégiale, les ducs de Lorraine sont alors les seuls à exploiter le sel à Dieuze. Les salines deviennent ducales.
Pendant plusieurs siècles la Lorraine est le terrain de batailles, de changement de pouvoir et de nationalité, en 1525, la saline et la ville sont deux entités distinctes séparées par des fortifications, les salines repassent sous l'administration royale quand la Lorraine revient de nouveau en France. Avec la signature de ce traité les fortifications sont détruites en 1700. Les salines s'agrandissent avec la construction du bâtiment de la direction et deviennent finalement nationales après la Révolution.
L'industrie chimique se développe et voit la fabrication de soude à partir de 1803, ainsi que de nouveaux produits chimiques. A partir de 1825 la mine est exploitée en souterrain et non plus seulement par sondages. A partir de 1842 l'Etat renonce à son monopole et vend la saline, elle devient Compagnie des Anciennes Salines Domaniales de l'Est en 1862. La saline ainsi que la Lorraine est annexée par l'Allemagne entre 1870 et 1918. Après la Première Guerre Mondiale et le retour en France l'usine est reprise par les Etablissement Kuhlmann. Pendant la Seconde Guerre Mondiale elle est exploitée de nouveau par des allemands.
L'usine finalement reprise s'oriente désormais totalement vers une production de produits chimiques et non plus de sel. En 1966 l'usine fusionne avec Ugine, puis en 1971 avec Pechiney. La production de sel est définitivement arrêté en 1973. Pendant une vingtaine d'années la dénomination de société est maintes fois modifiée entre acquisitions et fusions, le site passe sous le joug de Total, après avoir fusionné avec Fina et Elf. L'usine ferme finalement définitivement ses portes en 2006.
 Voici l'entrée principale de la saline, la porte est le premier élément distinctif de la saline, tout comme à Marsal (voir plus bas). La porte et le pont sont construit en 1774 par décision du roi.
Voici l'entrée principale de la saline, la porte est le premier élément distinctif de la saline, tout comme à Marsal (voir plus bas). La porte et le pont sont construit en 1774 par décision du roi.
En pénétrant dans la saline, les premiers bâtiments visibles sont aujourd'hui : le puits salé en face, la direction sur votre droite et la délivrance sur votre gauche. Le bâtiment de la direction autrefois appelée la "Recette" (pour la perception de la gabelle) a toujours eu un rôle administratif. A côté se trouve la maison du directeur.
 La délivrance n'est autre qu'un magasin à sel. L'origine de son nom provient de son rôle dans le fonctionnement de la saline : il délivre le sel aux voituriers. L'ensemble du bâtiment (100m de long sur 30m de large) est destiné au stockage du sel, celui-ci est cloisonné dans des loges qui séparent sa qualité, sur toute la hauteur du bâtiment (13m de haut). Évidemment toute la charpente et cloisons sont faites en bois. Le sel est dispatché par des wagonnets circulant sous le toit. Treize portes de plain pied permettent l'accès aux loges, par la suite un quai est construit en devanture, facilitant le chargement.
La délivrance n'est autre qu'un magasin à sel. L'origine de son nom provient de son rôle dans le fonctionnement de la saline : il délivre le sel aux voituriers. L'ensemble du bâtiment (100m de long sur 30m de large) est destiné au stockage du sel, celui-ci est cloisonné dans des loges qui séparent sa qualité, sur toute la hauteur du bâtiment (13m de haut). Évidemment toute la charpente et cloisons sont faites en bois. Le sel est dispatché par des wagonnets circulant sous le toit. Treize portes de plain pied permettent l'accès aux loges, par la suite un quai est construit en devanture, facilitant le chargement.
En 2013, le bâtiment a été entièrement refait, une grande partie de la charpente a été restaurée mais aussi conservée : les poutres noircies par le temps témoignent de leur ancienneté. Aujourd'hui le site sert de salle de spectacle, salle des fêtes, et d'espace culturel notamment pour la saline.
 Voici une reconstitution d'un bâtiment de graduation, il y en avait plusieurs sur le site auparavant. Cela sert à concentrer la saumure. Pour rappel, il n'en existe plus aucun en France. Ce type de bâtiment a été inventé en Allemagne, où il en existe encore près d'une centaine.
Voici une reconstitution d'un bâtiment de graduation, il y en avait plusieurs sur le site auparavant. Cela sert à concentrer la saumure. Pour rappel, il n'en existe plus aucun en France. Ce type de bâtiment a été inventé en Allemagne, où il en existe encore près d'une centaine.
Le principe est simple, afin de réduire l'utilisation du bois de chauffage pour former le sel dans la poêle, la saumure est avant tout concentrer, c'est à dire que l'on augmente la salinité de la solution. Pour ce faire, la saumure qui sort du puits salé par une goulotte à l'arrière du bâtiment s'écoule dans un canal puis est déversée sur une série de fagots condensée afin d'augmenter la séparation. L'évaporation qui se produit avec l'air augmente alors le degrés de salinité : l'eau est évaporée, la saumure est récupérée au pied de la graduation.
 Voici le bâtiment du puits salé, jusqu'en 1826 seul ce puits servait à la production de sel. Sa porte principale extérieure se caractérise par un fronton rappelant la fonction du bâtiment adjoint de chaque part par un oculus représentant la saumure et surmonté en son toit par une tour carré avec une horloge. L'ensemble du bâtiment accueille le puits, la machinerie et le manège, que nous allons voir.
Voici le bâtiment du puits salé, jusqu'en 1826 seul ce puits servait à la production de sel. Sa porte principale extérieure se caractérise par un fronton rappelant la fonction du bâtiment adjoint de chaque part par un oculus représentant la saumure et surmonté en son toit par une tour carré avec une horloge. L'ensemble du bâtiment accueille le puits, la machinerie et le manège, que nous allons voir.
 Voici le manège, il s'agit d'une reconstruction, celui-ci fonctionne avec huit chevaux attelés deux par deux, et permet d'actionner la roue dentée (8,5m de diamètre/2,5 tonnes) située au dessus (4,5m de hauteur), elle permet alors de mettre en mouvement un axe horizontal par le biais d'un rouet, cet axe prolongé est perpendiculaire au puits auquel est attaché une noria de seaux ou chaîne à chapelet.
Voici le manège, il s'agit d'une reconstruction, celui-ci fonctionne avec huit chevaux attelés deux par deux, et permet d'actionner la roue dentée (8,5m de diamètre/2,5 tonnes) située au dessus (4,5m de hauteur), elle permet alors de mettre en mouvement un axe horizontal par le biais d'un rouet, cet axe prolongé est perpendiculaire au puits auquel est attaché une noria de seaux ou chaîne à chapelet. Cette chaine munie de rondelles en cuir cousues dans du tissu ou feutre, fixées de place en place sur la chaîne sans fin qui glisse dans un cylindre vertical dans son circuit ascendant. La saumure, maintenue entre deux rondelles remonte alors vers la surface où elle est déversée
.
 Voici une vue d'au dessus pour mieux comprendre : une au dessus du puits avec une reconstitution de la chaine (une corde maintenant) et des seaux en cuirs (des godets aujourd'hui) plongeant dans la saumure, et de l'autre la roue permettant le mouvement de plonge et de remonte de la chaine.
Voici une vue d'au dessus pour mieux comprendre : une au dessus du puits avec une reconstitution de la chaine (une corde maintenant) et des seaux en cuirs (des godets aujourd'hui) plongeant dans la saumure, et de l'autre la roue permettant le mouvement de plonge et de remonte de la chaine.
Enfin en dernier voici un bel exemple de saumoduc.
Marsal
La vallée de la Seille est le gisement de sel le plus important situé en zone continentale. Il s'agit d'une plaine alluviale marécageuse, où le gîte salifère se trouve à 50m de profondeur, sa puissance est d'environ 70m, l'apparition de mares salées par résurgence a permis une exploitation du sel très tôt jusqu'au 17ème siècle.
Marsal idéalement situé entre la Seille et un canal de dessèchement devient une place forte du sel à partir du 13ème siècle où l'église contrôle son extraction jusqu'au 17ème siècle. Mais les Ducs de Lorraine et l'évêché de Metz s'affrontent régulièrement afin d'obtenir cette précieuse substance mais surtout pour recueillir la taxe de la gabelle. Finalement le Roi de France s'en empare en 1663 et les salines ferment en 1699. Vauban perfectionne les fortifications de la ville déjà en place (plan à sept bastions) pour faire face à l'ennemi voisin en démolissant et en relevant les remparts et fait construire de nouveaux bâtiments afin de loger la garnison de soldats. Cette période militaire s'étale jusqu'à la guerre de 1870. La saline ayant totalement disparue durant ces années, le site est acquis par l'Etat à partir de 1927, le musée du sel y est crée en 1973 et en 2004 c'est le département de la Moselle qui en est propriétaire.
 Les fissures de la roche calcaire ont laissées remonter en surface l'eau salée pour en former des mares. Le sel était récupéré par la méthode dite du briquetage, une fois la saumure extraite, elle cuite à l'intérieur de fours dans des moules de terre de cuite. Cassés après cuisson, ces moules ont laissés d'immenses dépôts de briquettes. Ces volumes importants ont permit l'édification des villages dans ces plaines marécageuses. Marsal constitue le site de briquetage le plus considérable d'Europe, les débris empilés et recouverts de limons ayant formé un îlot d'un kilomètre de diamètre, soit près de deux millions de m³
Les fissures de la roche calcaire ont laissées remonter en surface l'eau salée pour en former des mares. Le sel était récupéré par la méthode dite du briquetage, une fois la saumure extraite, elle cuite à l'intérieur de fours dans des moules de terre de cuite. Cassés après cuisson, ces moules ont laissés d'immenses dépôts de briquettes. Ces volumes importants ont permit l'édification des villages dans ces plaines marécageuses. Marsal constitue le site de briquetage le plus considérable d'Europe, les débris empilés et recouverts de limons ayant formé un îlot d'un kilomètre de diamètre, soit près de deux millions de m³
 Voici la Porte de France, appelée Porte Notre-Dame avant 1663 qui représente l'accès principal au village, autrefois deux passages parallèles existaient, l'un pour la saline et l'autre pour la place forte, après la fermeture de la saline le premier fût fermé. Les rainures pour le passage des chaines, afin d'actionner le pont-levis est encore bien visible en façade. Son utilité dorénavant militaire la transforme en logements d'officiers, le fronton est remplacé par un étage d'attique éclairé par cinq fenêtres, elle abrite également un corps de garde, une buanderie et des prisons militaires.
Voici la Porte de France, appelée Porte Notre-Dame avant 1663 qui représente l'accès principal au village, autrefois deux passages parallèles existaient, l'un pour la saline et l'autre pour la place forte, après la fermeture de la saline le premier fût fermé. Les rainures pour le passage des chaines, afin d'actionner le pont-levis est encore bien visible en façade. Son utilité dorénavant militaire la transforme en logements d'officiers, le fronton est remplacé par un étage d'attique éclairé par cinq fenêtres, elle abrite également un corps de garde, une buanderie et des prisons militaires.
Au centre des deux portes se trouve un médaillon armorié surmonté de la date de 1774, la façade avant du bâtiment est habillé d'un appareillage de bossages à refends en calcaire avec des pilastres d'ordre dorique, cela rappelle le style de la saline d'Arc-et-Senans.
 Devant l'une des portes se trouve une pompe pour l'extraction de la saumure. Voici son fonctionnement :
Devant l'une des portes se trouve une pompe pour l'extraction de la saumure. Voici son fonctionnement :
Une bielle reliée à un vilebrequin imprime un mouvement alternatif à un balancier. Une des extrémités du balancier supporte les tiges de commande du piston de la pompe immergée. A l'autre extrémité est fixée une masse de fonte équilibrant le poids des tiges. La pompe proprement dite, toujours noyée dans une nappe d'eau salée se compose d'un clapet de pied et d'un piston possédant lui même un clapet. Le mouvement de ce piston est commandé par les tiges reliées au balancier faisant partie de l'installation.
Pendant le course descendante du piston le clapet de pied reste fermé et la saumure passe au dessus du piston par son clapet ouvert. Quand le piston remonte, son clapet se referme et la colonne de saumure située au dessus remonte vers la surface du sol où elle est recueilli. Simultanément, le clapet de pied se soulève et une nouvelle quantité de saumure pénètre dans le corps de la pompe sous le piston. Le travail essentiel de la pompe se produit pendant la course ascendante du piston.
 Quatre casernes au total sont construites par Vauban, deux à chaque entrée de la ville. Chaque caserne se caractérise par 12 écuries, 24 chambres et un grenier à vivres. Aujourd'hui il n'en plus que trois, deux près de la Porte de France et une près de la Porte de Bourgogne.
Quatre casernes au total sont construites par Vauban, deux à chaque entrée de la ville. Chaque caserne se caractérise par 12 écuries, 24 chambres et un grenier à vivres. Aujourd'hui il n'en plus que trois, deux près de la Porte de France et une près de la Porte de Bourgogne.
Moyenvic
Les sources salées de Moyenvic sont exploitées depuis l'époque des Celtes avec une première méthode que l'on appelait : le briquetage. Une fois la saumure récupérée celle-ci était stockée dans des pots en argiles et placée au dessus de petit fours. Cette opération était recommencé une nouvelle fois afin d'augmenter l'évaporation et obtenir un pain de sel le plus pur possible. Ces fours étaient conçus en boudins d'argiles formant une grille afin de pouvoir disposer tous les pots à faire chauffer.
Ces fours dont quelques vestiges de briques sont encore visibles dans les champs témoignent de l'ancienneté de l'exploitation du sel dans cette région.
Durant l'époque Romaine, le sel est évaporé grâce à des poêles à sel.
Il faut attendre le 9ème siècle pour que la saline de Moyenvic soit attestée, elle est alors exploitée par des souverains puis des religieux puissants, les ducs de Lorraine et enfin le Roi de France en vertu du Traité de Vincennes en 1661.
La saline de Moyenvic est construite en plein centre ville de la commune sur environ six hectares, comme à Marsal elle possédait ses propres fortifications. Le puits de 17m de profondeur pompait la saumure provenant de sept sources. En 1745 un saumoduc de 13km est construit afin d'amener la saumure de Dieuze, plus salée. Durant la Révolution les salines (Château-Salins, Dieuze et Moyenvic) sont nationalisées et regroupées sous une seule et même compagnie : les Salines de l'Est.
A partir de 1831, toute la production de sel est concentrée sur le site de Dieuze, celle-ci est agrandie et remise à neuf de 1806 jusqu'en 1822. A Moyenvic, l'exploitation est en suspens quelques temps avant d'être rachetée par le comte Yumuri vers 1847 et perdurera jusqu'en 1897.
La saline est rachetée par la suite par différents propriétaires avant d'être totalement détruite durant la Seconde Guerre Mondiale.
 Ce bâtiment servait de porte d'accès à la saline et abritait le logement du gardien.
Ce bâtiment servait de porte d'accès à la saline et abritait le logement du gardien.
Est ce que cette borne servait à délimiter l'emprise de la saline entre les communes de Vic-sur-Seille et de Moyenvic ?
Sarralbe
La présence de sel dans le sous-sol de Sarralbe était déjà connue au 13ème siècle sous le nom de saline d’Albe signalée par un puits à Salzbronn. On se servait des eaux salées pour fabriquer du sel dans 7 chaudières jusqu’au temps de la gabelle. L’exploitation de ce puits se poursuivra jusqu’au début du 19ème siècle.
En 1827, la compagnie De Thon et Dorr démarre l’exploitation industrielle du sel à Sarralbe. Plusieurs sondages sont réalisés et la preuve est faite que le dépôt salifère de Salzbronn n’apparaît pas comme celui de Vic et de Dieuze en terrain de marne mais en terrain plus ancien de calcaire coquillier. La société chercha à conserver le monopole dans la région en prétendant y avoir découvert le sel gemme. Sa production ne dépassa jamais 2000 tonnes par an.
L’abolition du monopole du sel par la loi du 17 juin 1840 et le succès de la compagnie De Thon provoquèrent la création de trois nouvelles salines au 19ème siècle :
- Les salines du Haras exploitées de 1843 à 1966
- Les salines Gagnerot et Cie exploitées de 1844 à 1956
- Les salines Solvay et Cie exploitées de 1885 à 1947
En Lorraine annexée, la production des salines va plus que doubler de 1871 à 1914. En 1935, la production totale à Sarralbe était de 45 000 tonnes de sel par an alors que la production totale des sels raffinés en Lorraine était de 200 000 tonnes par an.
La reconversion des activités de fabrication industrielle du carbonate de soude par la société Solvay au début des années 70 donnera une nouvelle dimension économique à la ville basée sur la pétrochimie.
 Voici la source de Salzbronn. Ce bâtiment est daté de 1827.
Voici la source de Salzbronn. Ce bâtiment est daté de 1827.
 Et ici le site de l'ancienne soudière Solvay
Et ici le site de l'ancienne soudière Solvay