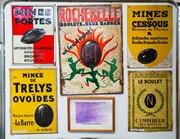Groupe Sud
Mine témoin
Il s'agit de l'ancien centre de formation des mineurs de la mine de Rochebelle, plus communément appelé "Quartier Mine Témoin" Il est ouvert en 1945 jusqu'en 1968 date de fermeture des mines de Rochebelle.
 Ce chevalement provient du puits Alexandre (SFA)
Ce chevalement provient du puits Alexandre (SFA)
 Les anciennes galeries de formation servent aujourd'hui de visite au musée de la Mine.
Les anciennes galeries de formation servent aujourd'hui de visite au musée de la Mine.
 Il s'agit du terril du mont Ricateau (le plus haut) et un peu en dessous de celui de Rochebelle. Il y a encore quelques années un incendie dans la forêt domaniale a provoqué la mise en combustion des deux terrils, on a mesuré des températures de 900 degrés à -20m du sol. Cela a eu pour effet de produire du monoxyde du carbone, ce gaz combiné avec de l'eau peut devenir plus dangereux et se transformer en hydrogène, soit un gaz explosif. L'opération délicate a donc consister à "découper le terril" afin de pouvoir accéder aux parties les plus chaudes et ainsi les éteindre. On appelle cela défourner un terril.
Il s'agit du terril du mont Ricateau (le plus haut) et un peu en dessous de celui de Rochebelle. Il y a encore quelques années un incendie dans la forêt domaniale a provoqué la mise en combustion des deux terrils, on a mesuré des températures de 900 degrés à -20m du sol. Cela a eu pour effet de produire du monoxyde du carbone, ce gaz combiné avec de l'eau peut devenir plus dangereux et se transformer en hydrogène, soit un gaz explosif. L'opération délicate a donc consister à "découper le terril" afin de pouvoir accéder aux parties les plus chaudes et ainsi les éteindre. On appelle cela défourner un terril.
Mine de Ladrecht
Il s'agit du carreau de Ladrecht, où seront fonçés deux puits : le puits Fontanes et Destival
Le puits Fontanes est fonçé entre 1874 et 1878, on y installe également des ateliers de criblage, un lavoir et une agglomération. Le puits entre en service en 1884. Il a un diamètre de 4,3m et atteindra la profondeur de -411m au final. Il est modernisé à partir de 1929 avec le chevalement actuel, c'est à dire un chevalement métallique en poutrelles à treillis haut de 35m, la machine d'extraction précédemment à vapeur passe à l'électricité, avec la nouvelle centrale thermique de Rochebelle. Le puits est équipé par une machine d'extraction Venot à tambour bicyclindroconique.
La tour du puits Destival est construite en 1942, il s'agit d'une tour d'extraction en béton haute de 67m, atteignant -822m de profondeur. On y installe une machine d'extraction Venot à poulie Koepe en 1949. Le puits de Fontanes reste ouvert mais ne sert plus qu'au service et à l'aérage. Toute la production du secteur Sud est maintenant concentrée ici (liaison entre les travaux miniers de Rochebelle et Saint-Martin-de-Valdargues).
A partir de 1980, il est décidé de fermer la mine. S'en suit un mouvement de grève de la part des mineurs qui occuperont le fond pendant 13 mois (actuellement la plus longue grève en Europe) de Mai 1980 à Juin 1981. En 1981, une fresque est même crée sur l'un des murs en contrebas du chevalement, symbolisant le combat des mineurs. Avec le changement de politique intervenu à ce moment là, rien ne changera et la mine fermera malgré tout en 1985.
L'ensemble du site est racheté par la Communauté de Commune en 1989, le chevalement du puits Fontanes sera conservé en mémoire alors que la tour Destival, jugé trop dangereuse, par son délabrement sera détruite en 2002. Seule rescapée, la molette de la tour, trône actuellement sur l'un des ronds points de la ville. Le site accueille aujourd'hui une zone artisanale avec quelques PME.
 Le chevalement a été repeint en rouge.
Le chevalement a été repeint en rouge.
 Au fond c'est le terril du mont Ricateau (Cf: Puits Fontanes).
Au fond c'est le terril du mont Ricateau (Cf: Puits Fontanes).
Puits Saint Germain
Le puits est foncé en 1867 par la Société de Saint-Germain-les-Alès et atteint la profondeur de -140m avec un diamètre de 3,7m. L'exploitation est arrêtée vers 1920, et la concession reprise en 1941 par la Compagnie Houillère de Rochebelle. Le remblaiement du puits intervient en 1973.
Le chevalement est une tour en pierres et briques haute de 14m et percé par quatre grandes arches en plein cintre dans chacune de ses faces.
Groupe Centre
Puits de la Trouche
Afin de développer l'extraction du charbon de la "Grand Baume", il a été envisagé de fonçé plusieurs puits car les affleurements arrivaient à épuisement. Le puits de la Trouche fait donc partie d'une série de travaux visant à améliorer l'extraction, cinq puits sont foncés par la Compagnie des Mines de la Grand'Combe.
- Le puits Mourrier (1846) : pour l'extraction
- Le puits 1 dit du Gouffre (1855) : pour l'extraction et l'épuisement
- Le puits 2 dit du Ravin (1855) : pour l'extraction et l'aérage
- Le puits 3 dit de Trescol (1851) : pour l'extraction, retour d'air
- Le puits 4 dit de la Trouche (1848) : pour l'extraction et l'épuisement.
Le puits sert à l'extraction du charbon jusqu'en 1870, où il dessert deux accrochages à -24m et -52m pour une profondeur totale de -54m. Puis il sert d'aérage pour les chantiers du puits de la Fontaine 1 et le puits de Trescol, puis pour l'exhaure en 1925, et de nouveau à l'extraction en 1946 avec une nouvelle machine d'extraction électrique avant d'être à l'arrêt vers 1949.
Le charbon sortant du puits est acheminé au lavoir de Trescol situé plus bas dans la vallée, les berlines empruntaient une voie ferrée avant de rejoindre une galerie souterraine en pente douce qui les amenaient à Trescol. Les berlines vides remontaient par des plans inclinés.
Le chevalement est l'un des rares vestiges de puits de cette époque, il s'agit d'une tour en pierre maçonnées (grès) de 5m de côté sur 9m de haut. Il comporte un arc cintré sur deux de ses faces et deux sur ses deux autres côtés (l'un au dessus de l'autre).
 Il reste juste à côté les logements miniers (un seul bâtiment sur les deux qui ont été construits) dit Larguier Jeune.
Il reste juste à côté les logements miniers (un seul bâtiment sur les deux qui ont été construits) dit Larguier Jeune.
Puits Ricard
Après la découverte d'un gisement riche en anthracite peu profond, il est décidé de foncé un nouveau puits : le puits Ricard. Il est foncé entre 1932 et 1934 par la Société Anonyme des Anciens Etablissements de Hulster, Faibie et Cle. Le puits atteint la profondeur de -801m avec un diamètre de 5m. Il permet l'extraction de trois couches de 4,7m, 1,7m et 10,5m situées entre -738m et -795m.
Le puits est équipé d'un chevalement métallique de 31,5m de haut et d'une machine d'extraction à tambour bicylindroconique Venot-Peslin, avec un moteur CEM de 1200CV.
Le chevalement est partiellement détruit en 1938 (le jour de la Sainte Barbe) par un incendie (2 morts), ses poussards sont renforcés par du béton armé (1939) par Charles Tournay, ingénieur et industriel belge qui est en charge de sa reconstruction, il fera une chute du haut du chevalement qui lui en coûtera la vie durant ces travaux.
La mine ferme en 1978.
Il a été classé à l’inventaire des Monuments Historiques le 14 mai 2008 et est devenu un musée ou il accueille la Maison du Mineur.
 Il s'agit du bâtiment des bains-douches et de la salle des pendus mais ici on l'appelle le lavabo Ricard.
Il s'agit du bâtiment des bains-douches et de la salle des pendus mais ici on l'appelle le lavabo Ricard.





 Il s'agit d'un atelier de mécanique pour les lampes de sûreté sur le modèle de la lampe de JB Marsaut, crée par Casimir Raymond, initialement crée a Rochessadoule en 1873, mais remonté ici par un groupe de mineurs bénévoles. Cet atelier est encore entièrement fonctionnel.
Il s'agit d'un atelier de mécanique pour les lampes de sûreté sur le modèle de la lampe de JB Marsaut, crée par Casimir Raymond, initialement crée a Rochessadoule en 1873, mais remonté ici par un groupe de mineurs bénévoles. Cet atelier est encore entièrement fonctionnel.
 Les lavabos sont divisés en trois zones :
Les lavabos sont divisés en trois zones :
- Pour les ouvriers : 162 douches réparties de chaque côté du bâtiment et 1397 pendus dans la partie centrale.
- Pour les jeunes : 32 douches, 60 armoires et 216 pendus.
- Pour les ingénieurs : 18 douches en cabines individuelles et 60 armoires.
 Ce grand hall qui abrite le musée de la mine est l'ancien bâtiment des douches et salle des pendus, il y avait 180 douches pour 1800 pendus.
Ce grand hall qui abrite le musée de la mine est l'ancien bâtiment des douches et salle des pendus, il y avait 180 douches pour 1800 pendus.
 Voici l'escalier emprunté par les mineurs pour rejoindre le puits.
Voici l'escalier emprunté par les mineurs pour rejoindre le puits.
 Dans le puits tout est presque automatisé. Au décagement, les berlines sortent du bâtiment de recette et vont être culbutées dans un autre bâtiment prévu à cet effet (Cf: Circuit charbon, de droite à gauche) De nouveau vides, les berlines remontent au niveau du puits prêtes à être encagées.
Dans le puits tout est presque automatisé. Au décagement, les berlines sortent du bâtiment de recette et vont être culbutées dans un autre bâtiment prévu à cet effet (Cf: Circuit charbon, de droite à gauche) De nouveau vides, les berlines remontent au niveau du puits prêtes à être encagées.
 Machine d'extraction à tambour bicylindroconique de la firme Venot entraîne par un moteur développant 1200CV et muni par deux freins de chaque côté. Le tambour principal mesure 6,1m et 3.9m pour les deux autres. Derrière la machine se trouve les deux groupes convertisseurs Ward Leonard délivrant le courant continu. Juste à côté se trouve un compresseur d'air Rateau et un compresseur Vilbiss, au fond l'armoire électrique de distribution de 5000V.
Machine d'extraction à tambour bicylindroconique de la firme Venot entraîne par un moteur développant 1200CV et muni par deux freins de chaque côté. Le tambour principal mesure 6,1m et 3.9m pour les deux autres. Derrière la machine se trouve les deux groupes convertisseurs Ward Leonard délivrant le courant continu. Juste à côté se trouve un compresseur d'air Rateau et un compresseur Vilbiss, au fond l'armoire électrique de distribution de 5000V.
Autres vestiges
 La galerie Sainte Barbe est construite à partir de 1902 pour développer l'exploitation des puits du Pontil, de Castelnau, de la Forêt et plus tard celui de la Fontaine. Elle est mise en service en 1909 et fermée en 1963. Aujourd'hui elle sert comme galerie d'exhaure.
La galerie Sainte Barbe est construite à partir de 1902 pour développer l'exploitation des puits du Pontil, de Castelnau, de la Forêt et plus tard celui de la Fontaine. Elle est mise en service en 1909 et fermée en 1963. Aujourd'hui elle sert comme galerie d'exhaure.



 Le puits de la Verrerie est fonçé en 1938 pour permettre la jonction des mines de Luce, Abilon et Pilhouse vers le nouveau puits Ricard, à partir de trois accrochages à -40m, -90m et -150m. Il est mis en service en 1945 et arrêté en 1953.
Le puits de la Verrerie est fonçé en 1938 pour permettre la jonction des mines de Luce, Abilon et Pilhouse vers le nouveau puits Ricard, à partir de trois accrochages à -40m, -90m et -150m. Il est mis en service en 1945 et arrêté en 1953.




 Tunnel de liaison reliant le Puits des Oules 2 au puits Ricard.
Tunnel de liaison reliant le Puits des Oules 2 au puits Ricard.
 La galerie de Therond (1840-1964) dans le secteur de Champclausson était reliée à plusieurs puits dont celui de Pétassas, Serre et Felgie et également à la galerie de Cornas. En 1937 un travers banc fût creusé dans la galerie et permit de découvrir une couche de charbon appelée Corniche. D'où l'emploi du double nom pour cette entrée.
La galerie de Therond (1840-1964) dans le secteur de Champclausson était reliée à plusieurs puits dont celui de Pétassas, Serre et Felgie et également à la galerie de Cornas. En 1937 un travers banc fût creusé dans la galerie et permit de découvrir une couche de charbon appelée Corniche. D'où l'emploi du double nom pour cette entrée.
 Entrée de la galerie des Luminières, aujourd'hui noyée. Elle est ouverte en 1935 et rejoignait les travaux de la Corniche. En 1938 le quartier de Champclauson fût mis en relation avec le puits de la fontaine 2 et plus tard en1942 avec la galerie Sainte Barbe. A partir de 1954 la galerie est mise en connexion avec la concession de Cessous. La galerie ferma en 1963.
Entrée de la galerie des Luminières, aujourd'hui noyée. Elle est ouverte en 1935 et rejoignait les travaux de la Corniche. En 1938 le quartier de Champclauson fût mis en relation avec le puits de la fontaine 2 et plus tard en1942 avec la galerie Sainte Barbe. A partir de 1954 la galerie est mise en connexion avec la concession de Cessous. La galerie ferma en 1963.
L'entrée d'origine était presque cinq fois plus haute qu'à l'heure actuelle !
 A l'origine le charbon sortant des mines de Champclauson était acheminé par voie ferrée gravitaire jusqu'à la Levade, puis remonté par un plan incliné automoteur et de nouveau descendu gravitairement jusqu'à Champclauson. Au fonçage du puits de la Fontaine 2, on pense alors à faire évacuer le charbon directement vers le puits (beaucoup plus pratique et surtout plus près). Un plan incliné avec treuil est alors installé et on creuse ce tunnel en 1932 afin de pouvoir faire circuler les locomotives toujours dans le bon sens à la remontée. Au final ce tunnel long de 55m ne sert qu'au demi-tour des locomotives. Il rentre dans la colline à angle droit et ressort en parallèle. On peux encore apercevoir un bout de voie Decauville au sol.
A l'origine le charbon sortant des mines de Champclauson était acheminé par voie ferrée gravitaire jusqu'à la Levade, puis remonté par un plan incliné automoteur et de nouveau descendu gravitairement jusqu'à Champclauson. Au fonçage du puits de la Fontaine 2, on pense alors à faire évacuer le charbon directement vers le puits (beaucoup plus pratique et surtout plus près). Un plan incliné avec treuil est alors installé et on creuse ce tunnel en 1932 afin de pouvoir faire circuler les locomotives toujours dans le bon sens à la remontée. Au final ce tunnel long de 55m ne sert qu'au demi-tour des locomotives. Il rentre dans la colline à angle droit et ressort en parallèle. On peux encore apercevoir un bout de voie Decauville au sol.
Notez au dessus de la sortie le rehaussement où était installé le treuil du plan incliné en direction du puits de la Fontaine 2
Groupe Nord
Dans le canton de Molières-sur-Ceze, plusieurs puits ont existé :
- Puits Chalmeton (Henri et Ferdinand Chalmeton) : fonçé en 1901, -581m sert comme puits d'extraction.
- Puits d'Estampes : fonçé en 1872, -207m sert comme puits de secours.
- Puits Silhol
- Puits Varin
 Le puits Varin tire son nom de la famille Varin d'Anivelle de Servas.
Le puits Varin tire son nom de la famille Varin d'Anivelle de Servas.
Deux puits sont fonçés, l'un pour l'aérage l'autre pour l'extraction, ils sont fonçés en 1866. Il est démoli en 1976. Aujourd'hui une partie du bâtiment d'extraction sert comme église.
Le bâtiment des bains douches du puits Varin est devenu une habitation.
 Le puits tire son nom d'Emile et Alfred Silhol, il est fonçé en 1863 à -750m comme puits d'extraction. En 1920 une centrale électrique est construite. L'ancien chevalement en pierre est détruit en 1945 afin d'être remplacer par plus moderne identique à celui de Saint Florent.L'arrêt de l'exploitation intervient en 1966 et la fermeture définitive en 1969. Le puits est démoli en 1973.
Le puits tire son nom d'Emile et Alfred Silhol, il est fonçé en 1863 à -750m comme puits d'extraction. En 1920 une centrale électrique est construite. L'ancien chevalement en pierre est détruit en 1945 afin d'être remplacer par plus moderne identique à celui de Saint Florent.L'arrêt de l'exploitation intervient en 1966 et la fermeture définitive en 1969. Le puits est démoli en 1973.
Dans le canton du Martinet :
Dans le canton de Gagnières :
- Puits Lavernède (1861-1929) -220m : Il sert pour l'exhaure et le matériel. Il reste une partie du bâtiment d'extraction, en ruine et envahi par les ronces. C'était selon moi l'un des plus beaux (il se situait dans une tour maçonnée) avec celui du puits Parran.
- Puits du Viaduc (1880-1925) -350m.
- Puits Thomas (1855-1929) -80m Il sert pour l'extraction puis l'aérage vers 1880.
- Puits Sirodo
- Puits Julien
- Puits Parran
- Puits de Chavagnac ou Puits des Mines d'Or (1866-1928), situé hors concession, ce puits n'a extrait du charbon que pendant la période 1917 à 1926. Il est d'abord exploité par Louis-Charles de Pagèze de Lavernède puis par son fils. La Société Française des Mines d'Or le rachète en 1910. Déclin progressif après la Première Guerre Mondiale et arrêt définitif en 1928. Il est transformé en habitation aujourd'hui. La vue présentée est celle vue de derrière.
Le puits Parran tire son nom d'Jean-Antoine Alphonse Parran, fondateur des exploitations de Mokta-el-Hadid, Krivoi-Rog et Gafsa (1826-1903)
Le puits est fonçé en 1870. Il est alors le second puits le plus profond de France avec -810m. Il est mis en service deux ans plus tard par la Compagnie des Mines de Fer Magnétique d'Ain Mokta-el-Hadid, Bouhamra et des Kalezos (Algérie)
L'extraction n'est pas assez rentable et c'est la Compagnie des Mines de Gagnières qui rachète le site en 1908. Une centrale électrique est construite à côté du puits datée de 1911. En 1924 la société est rachetée par la Compagnie Houillère de Bessèges avant sa fermeture vers 1926 et son arrêt définitif en 1929.

Dans le canton de Bessèges :
 Bessèges cumulait plusieurs mines, le charbon mais aussi des mines de fer.
Bessèges cumulait plusieurs mines, le charbon mais aussi des mines de fer.
Cette mine faisait partie de la concession dite du "Travers et de la Côte de Long"
Houillères de Graissessac

Le bassin de Graissessac est dans la continuité de l'ensemble des bassins houillers du Massif Central. Il s'agit du bassin le plus méridional. D'âge Stéphanien, c'est un synclinal étroit assymétrique d'axe Est/Ouest : il couvre une bande de 20km de longueur sur 1,5km de largeur. Il suit la vallée de l'Orb entre le Bousquet-d'Orb et la Tour-sur-Orb et se termine dans la Vallée de la Mare à Saint Geniest-de-Varensal et Castanet-Haut à l'Ouest.
Les couches de charbon, variables aux nombres de sept à huit et de un à six mètres d'épaisseur, sont divisées en plusieurs faisceaux (ici d'Ouest en Est):
- Faisceaux de Plaisance
- Faisceaux de la Rive Droite
- Faisceaux de la Rive Gauche
- Faisceaux de Verrières
- Faisceaux d'Orb
Les charbons extraits sont de la houille maigre anthaciteuse (10% à Plaisance), de la houille grasse à coke (34% au Bousquet) et de la houille demi grasse à quart grasse (56% à Graissessac).
Connu depuis l'époque des Gaulois et les Romains, les paysans tiraient des affleurements le charbon de terre pour leur usage personnel et au fonctionnement des forges artisanales pour les clouteries. Devenu rentable, le charbon est alors exploité plus fortement à partir de 1769 où débutent les premières concessions :
- Concession de Boussagues (1769)
- Concession du Bousquet-d'Orb (1778)
- Concession de Saint Gervais-sur-Mare (1789)
- Concession de Devois de Graissessac (1791)

La concession de Graissessac par sa position centrale est la plus petite (à sa formation), celle de Boussagues est la première a être ouverte le 04 novembre 1769 par Messieurs Giral et Moulinier. L'exploitation se fait notamment à Camplong. Afin de se développer, la société des mines absorbe en 1845 les deux autres sociétés et fusionne les quatre concessions, pour former la Compagnie Générale du bassin houiller de Graissessac, qui devient Compagnie des Quatre Mines Réunies de Graissessac en 1863. A partir de ce moment il s'agira de l'unique société exploitante. Ce monopole conduit à un grand champ d'exploitation représentant 7000 hectares de concessions. En 1836 deux autres concessions verront le jour : Concession de Castanet-le-Haut et Concession de Saint-Geniès-de-Varensal et Rosis. Le charbon est extrait à Camplong puis traité et expédié à partir de Graissessac. C'est aussi à ce moment que Graissessac devient une ville à part entière par la réunion des hameaux environnants (1859)

Cet effort de réunification est aussi marqué par l'arrivée du chemin de fer en 1858. Alors que les exploitations sont enclavées dans ces montagnes, la situation économique et industrielle va enfin permettre au bassin de se développer au niveau national mais aussi à l'international (Espagne). Cette ligne relie tout d'abord Béziers à Graissessac (1858) puis Saint Geniès-de-Varensal et le Bousquet (1865). Graissessac devient donc par ses actions le pôle central de transport de l'activité charbonnière. La Compagnie intensifie ses efforts avec la création du puits Padène à la même époque.
En 1925 la compagnie des Quatre Mines Réunies devient Compagnie des Mines de Graissessac jusqu'à la nationalisation. En 1937, la production dépasse les 20 millions de tonnes.
En 1946 les exploitations sont nationalisées, et dirigées par Charbonnages de France. Graissessac est intégré au groupe des Houillères des Cévennes, puis rattaché en 1968 aux HBCM sous le nom Unité d'exploitation de l'Hérault. L'extraction est alors orientée vers le Bousquet-d'Orb pour exploiter un nouveau faisceau. A Graissessac, cela se traduit par l'arrêt de l'extraction en souterrain mais le début à ciel ouvert (Découverte Padène). La fin de l'exploitation dans l'Hérault s'arrête en 1993.
Sources :
- Association Des Pierres et du Charbon (DPDC)
- Région Languedoc-Roussillon - Patrimoine culturel
- Le haut pays minier - Gilbert Crépel
- Etude du bassin houiller de Graissessac - Napoleon Garella
Quelques chiffres :
- 104 sites d'extractions, 10 puits fonçés.
- 224 ans d'exploitation (1769-1993)
- 1877 un coup de grisou tue 45 mineurs au puits Sainte Barbe. c'est la plus importante catastrophe minière.
Mine Simon
La mine tire son nom de l'ingénieur des mines : Aaron Benjaf Simon. La mine Simon est divisée en deux niveaux : inférieur et supérieur. Les vestiges concernent celle dite supérieure. Elle est ouverte en 1862 et permet d'exploiter les couches de charbon de la Rive Droite du Clédou (Grand Pas, Burelle, Ubertino, Thomas). On y accède par des descenderies, le charbon est atteint après 600m. On extrait jusqu'à 5 millions de tonnes dans ce secteur jusqu'en 1956. Le charbon était ensuite acheminé par un plan incliné aux bâtiments du Clédou et enfin envoyé par voie étroite jusqu'aux installations de traitements situées près de la gare de Graissessac.
La mine ferme vers 1930. La commune rachète le site en 2012, il est en cours de restauration en 2015.
 L'entrée de mine porte la date d'ouverture de la mine inscrite sur la clé de voûte.
L'entrée de mine porte la date d'ouverture de la mine inscrite sur la clé de voûte.
Tout autour se trouve encore les bureaux, bâtiments des machines, puits d'aérage, bâtiment des chaudières, et bâtiment du treuil.
 Après modernisation, les chantiers sont aérés par ce ventilateur plutôt que par le puits. Ce ventilateur est actionné par une machine à vapeur, puis par un moteur électrique.
Après modernisation, les chantiers sont aérés par ce ventilateur plutôt que par le puits. Ce ventilateur est actionné par une machine à vapeur, puis par un moteur électrique.
 Ce plan incliné tire son nom de Félix-Napoléon Garella, ingénieur des mines, qui fût le premier à s'intéresser au bassin de Graissessac et a dresser une topographie souterraine en 1838.
Ce plan incliné tire son nom de Félix-Napoléon Garella, ingénieur des mines, qui fût le premier à s'intéresser au bassin de Graissessac et a dresser une topographie souterraine en 1838.
Puits Durand
L'exploitation de la Rive Gauche débute dés le 19ème siècle par plusieurs mines à flanc de coteau (Mine Poupon, Mine Saint-Etienne, Mine Adèle) situées dans la concession de Boussagues. En 1873 la Compagnie décide de foncer un puits situé à la droite de l'Espaze afin d'accéder aux travaux du fond.
C'est le deuxième puits du bassin houiller. D'un diamètre atteignant 3m et sur une profondeur de 110m, le puits Durand communiquait à 18 m avec la mine Adèle, puis à 68m avec le travers-banc Durand et à 92m avec la recette et la salle des pompes. Grâce à ce puits, la couche Giral a été mise en exploitation entre 1883 et 1890, puis la couche Poupon à partir de 1925, et la couche Pilate en 1950. Une fois les wagons chargés de charbons bruts et remontés au jour, ils partaient via une galerie située au Nord du puits qui aboutissait à la mine Saint-Joseph (Graissessac).
A partir de 1960, alors que les travaux en découverte ont remplacé les travaux du fond, le puits Durand continue d'être utilisé pour relier, par une voie souterraine de 6,5 km (travers-banc 250), les concessions du Devois de Graissessac et de Boussagues au carreau Debay (Le Bousquet-d'Orb). Le charbon brut extrait des découvertes était transporté par camions jusqu'au puits Durand. Il était déchargé sur une grille installée contre la tête du puits et utilisée pour couper les mottes, remplacée en 1985 par une installation de criblage. Les mottes concassées étaient ensuite acheminées, par un tapis roulant, jusqu'à une trémie en béton, puis dirigées dans un descendeur hélicoïdal constitué d'une hélice métallique de 70 cm de large. Le descendeur était relié à un plancher incliné, construit 60 m plus bas, et communiquant avec le rampant. Ce plancher était prolongé par une trémie équipée d'une trappe permettant de charger les berlines. Le convoi était formé de 15 wagons (contenant 6 m3 de charbon) tractés par une locomotive électrique, formant un train de 100 m de long. Il effectuait 7 voyages par poste, à raison de deux postes par jour.
La mine ferme le 31 juin 1993.
 Il reste aujourd'hui comme seul vestige le chevalement, un portique métallique, qui servait pour le personnel, le matériel et le minerai.
Il reste aujourd'hui comme seul vestige le chevalement, un portique métallique, qui servait pour le personnel, le matériel et le minerai.
Puits Padène
Le puits de la Padène est ouvert en 1926 pour l'exploitation de la Rive Gauche du Clédou afin d'accéder aux couches profondes. Il communique avec les couches Poupon et Loubat.
L'exploitation en souterrain est arrêtée à Graissessac à la nationalisation mais transférée sur les travaux du Bousquet-d'Orb. L'exploitation en ciel ouvert débute alors en 1963 à la Padène. Les ateliers et magasins, alors obsolètes sont ré-utilisés d'abord par les fonderies de la Haute-Seine puis par la Fonderie des Cévennes en 1975.
 Il s'agit du centre névralgique du bassin de Graissessac : c'est ici que se trouvait l'ancienne gare où tous le charbon est expédié, le puits Padène, les bâtiments de traitements du charbon, les ateliers, magasins et les bureaux de la direction.
Il s'agit du centre névralgique du bassin de Graissessac : c'est ici que se trouvait l'ancienne gare où tous le charbon est expédié, le puits Padène, les bâtiments de traitements du charbon, les ateliers, magasins et les bureaux de la direction.
Il ne reste aujourd'hui plus que le grand bâtiment carré représentant le magasin général et derrière accolé les deux grandes halles servant d'ateliers de réparation (il n'en reste qu'une debout).
 Il ne subsiste que les parties basses du lavoir (le lavoir était adossé à la pente du coteau) où se trouve encore quelques trémies en béton.
Il ne subsiste que les parties basses du lavoir (le lavoir était adossé à la pente du coteau) où se trouve encore quelques trémies en béton.
 Le "château" de la direction se traduit par une architecture de style néo-mediévale avec sa tour hexagonale à son angle et ses créneaux entourant la toiture. Il est construit en 1863 pour abriter les bureaux, la comptabilité et le siège social de la Compagnie.
Le "château" de la direction se traduit par une architecture de style néo-mediévale avec sa tour hexagonale à son angle et ses créneaux entourant la toiture. Il est construit en 1863 pour abriter les bureaux, la comptabilité et le siège social de la Compagnie.
 L'exploitation à ciel ouvert a profondément marqué le paysage. Il est encore possible de voir les couches de charbon (strates noires)
L'exploitation à ciel ouvert a profondément marqué le paysage. Il est encore possible de voir les couches de charbon (strates noires)
Entrées de mines
 Les deux premières photos montrent la galerie de la Taupe ainsi que son exhaure en troisième photo. Cette galerie de jonction permettait de ramener les berlines pleines du bas du plan incliné jusqu'ici au plateau Sainte Barbe.
Les deux premières photos montrent la galerie de la Taupe ainsi que son exhaure en troisième photo. Cette galerie de jonction permettait de ramener les berlines pleines du bas du plan incliné jusqu'ici au plateau Sainte Barbe.
La dernière photo montre la galerie Sainte Barbe, elle fût ouverte en 1820.
Sur le plateau était également fonçé deux puits : le puits Sainte Barbe ainsi que son puits d'aérage recoupant trois recettes de galeries à -76m, -87m et -133m.
 Situé au bout du plateau Sainte Barbe ce tunnel permettait d'acheminer le minerai vers les ateliers de traitement situés au Puits Padène.
Situé au bout du plateau Sainte Barbe ce tunnel permettait d'acheminer le minerai vers les ateliers de traitement situés au Puits Padène.
 Il s'agit de la Mine de Grand-Champ (1872-1956) avec l'entrée des ouvriers à droite et la sortie du charbon à gauche, aujourd'hui complètement noyée. Il s'agit de la mine la plus ancienne du groupe inférieur. Les premiers travaux furent commencés en 1804 avant d'être rapidement arrêtés.
Il s'agit de la Mine de Grand-Champ (1872-1956) avec l'entrée des ouvriers à droite et la sortie du charbon à gauche, aujourd'hui complètement noyée. Il s'agit de la mine la plus ancienne du groupe inférieur. Les premiers travaux furent commencés en 1804 avant d'être rapidement arrêtés.